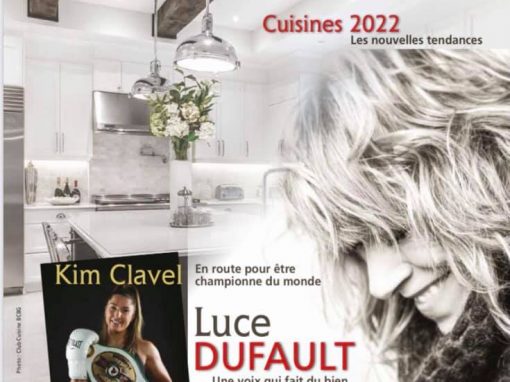Florence K ne rate jamais une occasion, avec raison, de parler de santé mentale. Parce que d’une part, il est important d’aborder le sujet, et aussi parce qu’elle sait ce que c’est, pour avoir à une certaine époque sombré dans la dépression et même fait quelques tentatives de suicide. Florence avoue qu’il lui a fallu tout son courage pour se livrer et raconter sa descente aux enfers dans son livre Buena Vida paru en 2015. Pour Regards de femmes, la chanteusea accepté de parler de santé mentale, de son retour aux études et bien sûr de son nouvel album, Florence, en vente depuis le 14 février dernier.
Texte et photos : Daniel Daignault
En général, est-ce que les gens sont encore réticents à parler de santé mentale?
Il y a deux choses, deux mouvements contraires en ce moment. Il y a des campagnes, le travail que Bell a fait au cours des six dernières années, entre autres, a vraiment amélioré les choses. Pas seulement Bell, mais d’autres organisations, sauf que ce n’est pas gagné. Il y a des campagnes où les gens parlent de santé mentale, font des levées de fonds, mais de l’autre côté de la médaille, quand ça leur arrive, ils ne savent même pas que c’est ça qui leur arrive. Et les premiers réflexes de quelqu’un qui est en dépression, sont de se dire : « Bien non, c’est moi le problème, c’est pas une maladie, je me plains pour rien, y en a qui l’ont pire que moi et tiens-toi, t’es fort. » Ça, c’est un symptôme de la dépression, c’est la culpabilité, le cycle de pensées négatives envers soi-même.

En somme, les gens qui se disent que ça ne se peut pas que ça leur arrive?
Oui, mais pas seulement ça, les gens qui ne l’ont pas vécu ne savent pas ce que c’est. On les lit les symptômes, mais on ne sait pas ce que c’est tant que ça ne nous arrive pas. Les gens souvent ne savent même pas vraiment ce qu’est un épisode de dépression, et que ça peut empirer, et que c’est important. L’autre affaire, c’est qu’une fois que tu le sais ou que tu as l’impression que c’est ça, les gens ne savent pas où aller. On m’écrit tous les jours, Daniel, pour me dire : « Je suis allé à l’hôpital et on m’a retourné le lendemain avec des pilules. Je n’ai pas de suivi et je n’ai pas d’argent pour voir un psychologue, je suis inscrit sur une liste d’attente. » Ou encore : « Je n’ai pas d’assurance, j’ai peur de le dire à mon boss pour éviter qu’il ne me fasse plus confiance au travail.» La peur est là et les gens ne savent pas où aller. Ça, c’est super difficile, la dépression est une maladie de riche. Il faut que tu aies l’argent pour la prévention et pour payer un psychologue. Ce ne sont pas seulement quatre séances qui sont payées par les assurances qui vont parvenir à régler un problème clinique. On parle de thérapie à long terme.
Tu as déjà dit que ça prend le dessus sur tout, sur tout le côté rationnel et j’imagine que lorsque ça nous arrive, on se demande ce que les gens autour de nous vont penser. On ne veut pas avouer qu’on est en dépression…
Exactement. Nos enfants, notre famille, il y a comme un déni aussi qui s’installe, et le déni fait partie des symptômes des troubles de santé mentale. Il ne faut pas blâmer les personnes qui le vivent, et le déni fait partie de ça. Combien de gens savent qu’il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, et qui sont dans le déni? Refuser de faire face à la réalité, ce n’est pas juste pour se protéger du jugement des autres, mais c’est un mécanisme d’adaptation, une façon de se protéger parce qu’on a peur de passer à travers tout le processus. Il y a plein d’enjeux en santé mentale qui ne sont pas assez explorés en ce moment, il faut y aller une étape à la fois.

Toi et bien d’autres qui prenez la parole contribuez à faire tomber les tabous…
Oui, il y a eu une conscientisation, on fait tomber les tabous, mais les gens ne savent pas quoi faire et où aller. On dit aux personnes : « N’hésite pas, appelle où il y a de l’aide, mais quand tu es un cas heavy, ce n’est pas évident. Moi, j’ai eu la chance d’avoir une super belle équipe quand j’étais en psychiatrie à l’Hôpital général juif. J’y étais allée trois fois avant d’être hospitalisée parce qu’il n’y avait pas assez de lits en psychiatrie, et ça veut dire que les soins de santé mentale sont le parent pauvre du système de santé. On parle d’un budget oscillant autour de 7% du budget total en santé. Mais d’un autre côté, on sait que 70% des appels faits aux policiers sont liés aux troubles de santé mentale. On s’entend qu’il y a un gros problème dans la gestion de la chose et on est vraiment loin du but. J’ai décidé de consacrer une grande partie de ma vie, en tant que personnalité publique et communicatrice, à prendre la parole pour que les gens sachent que c’est correct, qu’il y en a qui sont passés par là et qu’on peut s’en sortir. Et tant mieux si je peux faire quelque chose pour aider à améliorer la pensée du gouvernement face à ça, parce que moi-même, je l’ai vécu et je sais à quel point mon cas s’est empiré sans que je n’obtienne l’aide nécessaire.

Cet épisode est assez loin derrière toi, ça fait maintenant neuf ans, est-ce qu’on se remet complètement d’une dépression ou l’on est susceptible de retomber?
Ça varie vraiment d’une personne à l’autre. Dans mon cas, j’ai de la bipolarité de type 2, ça veut dire que j’ai eu de petites rechutes. Pas aussi graves que la première, et ça, c’est parce qu’on ne m’avait pas encore diagnostiqué bipolaire encore avec des phases dépressives. Ça a fait en sorte que ma médication n’était pas ajustée et actuellement elle l’est. Mais on dit que 60% des gens qui ont vécu un épisode dépressif majeur demeurent vulnérables à la chose par la suite. Il y a un travail de prévention de la rechute qui est important à faire aussi. Et il y a une grande partie des gens, si ce n’est la majorité, qui vont à l’hôpital en psychiatrie et ce n’est pas leur premier choix. Il y a un travail à faire après, mais il n’y a pas de ressources suffisantes. C’est pour cette raison qu’il y a énormément de coûts d’hospitalisation au lieu d’investir dans un suivi étroit. Ce n’est pas juste une question de donner des pilules et attendre que ça marche! En plus, durant les huit ou dix premières semaines d’antidépresseurs, il y a un risque d’avoir des idées suicidaires. Les médicaments te redonnent de l’énergie et si tes pensées suicidaires ne sont pas traitées, ça peut malheureusement inciter le monde à agir. Il faut donc être étroitement suivi et malheureusement, il n’y a pas de suivi, ni avant ni après. On est dans une situation difficile.

Il y a aussi un autre aspect : les campagnes qui sont faites, ce sont des associations, des organismes, des fondations qui s’occupent d’aider la majorité des gens. C’est donc un travail qui n’est pas assumé par le système de santé. La plupart des cliniques, CLSC et hôpitaux sont débordés, donc où réfère les patients à des organismes, des associations qui font leur propres collectes de fonds et à un moment donné, il y a une déresponsabilisation.

Tu as décidé d’étudier dans ce domaine là, la musique est-elle maintenant devenue un hobby, une passion?
Actuellement, je suis plusieurs cours et je fais une maîtrise par cumul à temps partiel à la TÉLUQ. Je suis des cours de mathématiques et de sciences et après, j’aurai plusieurs options. J’aimerais appliquer en psycho et être infirmière clinicienne en santé mentale, en médecine pour être psychiatre, et même en travail social. Tous ces domaines m’intéressent. À force de suivre les cours, ça va se définir, mais mon plus grand rêve est la psychiatrie. C’est aussi le domaine où c’est le plus difficile d’être admis, mais je me laisse le plus grand nombre de portes ouvertes. Je pense que la musique sera toujours en moi, j’ai fait un nouvel album qui est beau, j’ai besoin aussi de faire des spectacles, j’ai besoin de travailler. Mais en même temps, je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait. Ça ne me tente plus de me battre pour me faire connaître et me faire écouter. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, j’ai eu de super belles années et après, cela a été plus difficile. Heureusement, j’ai eu la radio qui m’a permis de faire de l’animation. Le travail qu’on a à faire est tellement immense par rapport à la valeur qu’on accorde à la musique, que les géants de l’internet accordent à la musique, que je me dis, tant qu’à travailler fort, j’ai désormais deux passions dans la vie : la musique et la santé mentale. La musique, je ne sais pas ce que je vais faire à l’avenir. Si à 50 ans ça va me tenter d’être en tournée, mais je sais qu’en santé mentale, il y a de grands besoins et j’ai un talent là-dedans. J’ai une grande passion et je travaille fort, et j’aime mieux consacrer mon énergie à quelque chose qui peut être du long terme. Sans mettre la musique complètement de côté.

J’ai eu peur de parler de mon retour aux études, je me disais que les gens n’allaient plus m’embaucher, qu’ils allaient penser que je ne fais qu’étudier, mais moi, j’ai besoin de travailler. En plus, je trouve que la qualité de mon travail ne s’en porte que mieux parce que quand j’ai fini ma journée d’étude, ça me fait du bien de me replonger dans la musique. En même temps, les études me sortent du côté hermétique et narcissique de la musique, de l’industrie de la musique. Je suis bien en ce moment, je me sens bien, je me sens à ma place. Je pense que l’expérience que j’ai vécue, que je sois capable d’en parler dans des termes non seulement personnels et émotifs, mais aussi d’expliquer les choses, ça peut vraiment servir à quelque chose. Je me dis qu’au moins, je n’aurai pas traversé ça pour rien.
J’imagine qu’il n’y avait pas beaucoup de monde autour de toi qui t’empêchait d’en parler…
Au début oui, avant de sortir mon livre. Il faut se rappeler qu’on était au début des années 2010, ce n’était pas comme aujourd’hui. C’était un pensez-y-bien, parce qu’on comprenait encore moins ce que c’était et il y avait encore plus de tabous. Ça m’a pris tout mon courage pour en parler, mais en même temps, mon éditrice m’a dit que ça allait vraiment aider du monde. J’avais une histoire à raconter, j’étais contente de l’écrire. J’avais peur des réactions, mais elles n’ont pas été négatives. Non seulement j’ai reçu des messages de remerciements parce que les gens disaient qu’ils avaient besoin d’en entendre parler et qu’ils pensaient qu’ils étaient seuls au monde à vivre ça, mais j’ai aussi eu des appels à l’aide. J’ai reçu quantité de messages personnels sur la messagerie de Facebook que j’ai référé aux bons endroits.

Par tes gestes, dirais-tu que tu as réussi à sauver des gens?
Il y en a qui m’ont dit qu’après m’avoir vue en entrevue, ils se sont rendus à l’urgence d’un hôpital. Mais ce n’est pas mon but de tomber dans la gratification. C’est juste que ça démontre qu’il y a un besoin d’aide immense dans notre société. Je le fais pour aider, mais par passion aussi, parce que je pense que le domaine de la psycho et de la santé mentale est pour moi la chose la plus fascinante.
Je suis contente que ton entrevue porte sur ce sujet parce que oui, on en parle beaucoup en plus des campagnes de publicité, et on a tendance à penser que c’est réglé, que ça marche. Mais la réalité que je vois, quand je fais des conférences et selon les messages que je reçois, est toute autre. Les travailleurs sociaux sont débordés dans les organismes, on le voit, on le lit. Et on voit que les psychiatres, les médecins, les intervenants sont débordés parce qu’il y a tellement de cas à traiter. C’est un problème qui va grandir, il y a plusieurs niveaux de problèmes de santé mentale et il faut poursuivre l’éducation. Dans les écoles, il y a des cours d’éducation physique, d’éducation sexuelle, et il faudrait qu’il y ait des cours d’éducation de bien-être. C’est sûr qu’on fait ce qu’on peut et si chacun apporte sa contribution par rapport à ce qu’il est capable d’offrir, qu’on continue à faire de l’information et de l’éducation, ce ne sera pas en vain et ça va nous mener quelque part.


En novembre 2018, Ben Riley et toi vous vous êtes mariés, parle-moi de lui un peu. Tu le connaissais avant d’écrire ton livre?
Je l’ai connu juste avant que mon livre soit publié, mais on ne sortait pas encore ensemble. Il était dans une relation et moi-aussi. Je le rencontrais de façon intermittente pour le travail quand j’allais à Toronto parce qu’il était batteur lors de spectacles. On s’entendait bien et à un moment donné, on a été tous les deux célibataires. On a travaillé ensemble un soir et on a discuté pas mal après le spectacle. C’était naturel, c’était fluide et ce l’est encore tellement; c’est un homme vraiment exceptionnel. Je suis avec un homme qui aime mon enfant comme si c’était le sien, un gars qui est à l’écoute et me soutient dans mes études et dans toutes mes décisions. Par exemple, il s’occupe de faire le souper si j’ai un travail à remettre et si j’en ai cinq, il va le faire tous les soirs! Il ne me dit jamais que je travaille trop, il est à l’écoute, c’est un gars qui est bon et ne procure que du bien à ma fille et moi. Ma famille et mes amis l’adorent, on rit beaucoup ensemble.

Un message de Florence publié sur sa page Facebook, en cette période trouble en raison de la Covid-19.
« Si vous sentez que votre santé mentale en prend un coup, que vous avez besoin d’aide, que vous souffrez d’anxiété, de dépression, que vous avez besoin d’être guidé, vous pouvez téléphoner au 1-866-revivre. Aussi, sur la page Facebook Mindstrong, en collaboration avec la Fondation de l’Hôpital Juif, on trouve plusieurs trucs pour l’autogestion, des outils pour vous aider à garder le cap, et des vidéos avec le Dr Karl Looper, psychiatre, seront mis à votre disposition dans les prochaines semaines. Je vous aime fort et honnêtement, je lève mon chapeau à tout le monde, parce qu’on est tous dans le même bateau! Un gros gros shoutout à tous les travailleurs du milieu de la santé et à ceux qui s’occupent de nos aînés. »